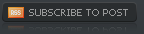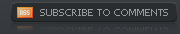On dit que la nuit s’est démocratisée, à Paris, dans les années 70, au Palace. Elle a pris, depuis, de nombreux visages. Quatre décennies, cinq personnages d’univers parallèles racontent autant d’histoires nocturnes d’une capitale encore bien vivace.
Ses nuits : « J’ai commencé à sortir tard, à 22 ans, en 72. Ma première boîte c’était le Sept, ouvert par Fabrice Emaer, rue Sainte Anne, un club gay assez chic et élitaire : on y croisait Yves Saint Laurent, Andy Warhol, des chanteuses américaines… La France se couchait à minuit, après la fin des programmes télévisés. La nuit, il n’y avait ni métro ni taxi, on ne pouvait pas venir de banlieue. Les étudiants faisaient la révolution mais ne sortaient pas en boîte de nuit. Quand Fabrice a ouvert le Palace, avec son goût pour les paillettes, le décorum, les garçons nus, ça a inauguré la nuit comme produit de consommation : c’était un théâtre assez grand pour accueillir des milliers de personnes. Il y a eu un changement sociologique, l’idée de faire la fête la nuit, de se déguiser et de trop boire s’est étendue. Maintenant, n’importe quel jeune se couche à 4 heures du matin, ça n’a plus rien d’exceptionnel. Le mélange des genres aussi, qui avait lieu là, où Saint Laurent et Roland Barthes dansaient avec la coiffeuse d’en face, c’était une utopie qui s’est tarie, notamment lorsque Emaer a soutenu la gauche, en 81, ce qui a déplu à sa clientèle à particule. Fabrice est mort en 82. Notre bande, dont Philippe Starck, Pierre et Gilles, Paquita Paquin, Christian Louboutin, a continué à sortir. Il y a eu beaucoup d’excès. Certains sont morts d’overdose ou du sida. Mais d’autres ont bien réussi. Il y avait même une ascension sociale possible dans le groupe comme celle de Farida Khelfa, égérie de Gaultier, copine de Carla Bruni, qui venait d’une HLM de Lyon. Une part de rêve. » Une nuit : « Vincent Darré, un copain de la bande, habillé en Mickey, fait mine de s’endormir sur Léon Zitrone (alors grande star de télévision, ndlr) pendant que je prends la photo. M. Zitrone, inconscient de la scène, ressemble à un dirigeant des républiques socialistes soviétiques. La photo traduit une insolence joyeuse caractéristique de l’époque. »
Ses nuits : « J’ai grandi entre la France et les Etats-Unis. Petit, mes oncles m’emmenaient à l’entrée des clubs américains, voir des strippeuses. J’ai commencé à aller au Palace à 14 ans, surtout pour les concerts de rock. J’avais une passion pour la danse et la musique. J’adorais les clubs qui étaient d’anciens théâtres avec leur touche music-hall et la musique black, le côté sexuel du disco, bien avant la fièvre du samedi soir. Je sortais dans tous les clubs mais je n’appartenais pas à une bande. Je pensais que c’était important de traîner dans des endroits, à Paris ou New York, où étaient Mick Jagger, Warhol, je connaissais Mugler, Gaultier… En 90, j’ai écrit pour Libération un article sur George Michael, que je croisais de temps en temps à L.A. Ça a été un succès immédiat : je le prenais au sérieux, je parlais de sa musique, de sa vie privée, ça ne devait pas trop se faire, ça a fait rêver. J’étais noctambule, donc je suis devenu préposé à l’air du temps et aux nouveautés. La colonne Nuits blanches est née dans la page de la météo, des mots croisés et des annonces minitel, donc j’y parlais de l’air du temps, de ce que disaient les gens, et de cul, de façon énigmatique, avec des personnages récurrents. Avant internet, il n’y avait que le journal à lire, et personne ne parlait vraiment de ce qui se passait la nuit à Paris. C’est devenu très public, et ça a duré de 1994 à 2006… J’en ai fait un instrument de critique sociale, pour transformer la perception des gens, leur donner une vision globale du monde. Ça parlait aussi du nouvel individualisme, ce côté Narcisse magnifié par les grands clubs mais qui allait signer leur fin. » Une nuit: « J’ai beaucoup décrit une fête aliénante, noire, en opposant la beauté de la nature et la violence d’une rave, qui était l’enfer pour moi, mais m’intéressait intellectuellement. Il y a un mois, j’étais à Central Park, en plein après-midi, là où se réunissent les rollerskaters. Il y avait un DJ latino qui passait des morceaux disco de l’époque du Studio 54. Je me suis retrouvé à danser pendant deux heures, dans le coucher de soleil, avec une foule de gens de 50 ans sur cette musique sans violence, généreuse, océanique. Un truc d’amour, de hippie qui avait su bien su capter, à l’époque, mon idée du bonheur. »
Ses nuits : « J’ai grandi dans le Val-de-Marne. Passé rapidement par les milieux punk anarchistes, puis reggae-raggamuffin, j’ai fait mon premier technival à 15-16 ans. J’ai rejoint les Heretik en 98, ils étaient déjà super actifs. Depuis deux ans, on faisait tous des fêtes tout le temps : on prenait des camions, du matos, on allait chercher des champs ou des hangars… Mais le collectif a vécu des heures sombres après la perte accidentelle de plusieurs membres, et une répression policière accrue. Heretik a décidé alors de devenir “activiste du son” : faire des coups, et ajouter de l’artistique. En 99, on a fait notre première grosse fête dans Paris, dans un énorme entrepôt vide sous Bercy, avec 3 000 personnes. Après ça, on a fait quelques fêtes et puis, en 2001, celle, historique, de la piscine Molitor. Peu après, la loi a changé, permettant notamment à la police de saisir le matériel. On a encore fait un gros technival, puis deux fêtes semi-légales avant que les choses, à l’initiative des politiques, ne deviennent davantage compliquées pour nous. On aurait bien continué les fêtes illégales comme au début, mais notre nom déplaçait 10 000 personnes ! En 2007, nous avons été invités au Zénith. Puis, l’apothéose : l’Olympia, en 2008. C’était légal, mais ça restait alternatif. Pour dix euros, tu avais douze heures de fête avec des DJ’s de folie, 180 personnes pour assurer des spectacles, sans logique commerciale. Pendant toutes ces années, on avait vécu en se démerdant : on partageait le loyer, un sweat noir à capuche et un jean, ça nous faisait 8 ans… Je me demande où sont les nouveaux mouvements alternatifs : ça n’a pas l’air de déranger les mecs d’être dans le business la journée, et encore dans la consommation le soir, aller écouter un DJ surpayé, se faire virer parce qu’ils n’ont pas les bonnes baskets. Il faut sortir un peu de la machine. Nous, on reste en veille. » Une nuit : « Des potes nous ont montré la piscine Molitor dans le 16e, à Paris. Un site classé, magnifique mais abandonné. On a préparé la fête pendant des mois : on faisait des rondes, on s’est déguisés en ouvriers, on a piqué des palissades, créé un pont-levis pour le camion. Le jour J, 6 000 personnes ont envahi le lieu en deux heures. Pas de débordements, rien, les CRS sont juste passés en pensant qu’on était des squatters qu’ils délogeraient plus tard. C’était une fête magnifique, jusqu’à 11 heures le lendemain matin. »
Ses nuits : « Je viens du terreau rock. Quand j’étais ado, mes frères étaient punk, j’ai cultivé le goût de la contre-culture et de l’alternative. Je me suis construit sur le mythe des losers magnifiques, le cuir, les mauvais garçons, le chaos. En banlieue, la nuit n’était pas glamour, Paris était trop loin. C’était la bande, les packs de bière, on rôdait en attendant l’incident qui allait pimenter notre soirée. Ambiance petites frappes. Je suis arrivé à Paris à 25 ans et je sortais aussi bien dans les free parties que les concerts punk ou rock, mais jamais dans les clubs. Je me suis beaucoup déglingué. A 30 ans, je me suis dit que si je continuais, j’allais m’enfoncer. J’étais alcoolique, et je souffrais de mon besoin de picoler. J’ai arrêté, je suis passé à l’âge adulte. Ça a fondamentalement changé mon rapport à la nuit. Quand tu picoles, tu n’as pas à affronter ton ennui, ton devoir de t’occuper l’esprit. La plupart des gens sortent plus pour boire que pour la musique. Le Baron, c’est un faux lieu : tu vas dans un endroit clos, tu files ton fric, tu te murges. Maintenant, en tant que patron de label, je suis sollicité par les clubs, mais j’y vais pour le boulot, je prends la thune, et je me casse. J’ai eu une grosse période de latence. Et puis j’ai retrouvé mes esprits. J’ai profité de mon licenciement d’une grosse maison de disques pour monter un label de vrai rock, “garage”, déviant, viril, qui se complaît dans la marge, qui cogne, avec le mode de vie et le folklore idoines. Sans velléité de conquérir le grand public. On veut juste être les meilleurs dans notre niche, à l’international, et on y arrive. Pour mettre en valeur mes artistes, j’ai lancé des soirées à la patinoire Pailleron. C’est sans alcool et les gens viennent patiner (500 mecs qui n’ont jamais patiné, si en plus ils buvaient, ce serait dangereux !). J’invite aussi des labels d’électro, de pop. Ça marche super parce que les gens s’impliquent, ils sortent du cynisme, se surprennent à s’amuser en patinant autour des DJ’s ou des groupes. Pour moi, c’est une vraie réussite. » Une nuit : « Ca me fait mal de dire ça, mais les “baby rockers”, Naast, Second Sex, pendant six mois, ça a été jubilatoire. On se retrouvait dans des salles avec des gamins de 15 ans survoltés sur scène, il y avait une dynamique et une émulation phénoménales. Malheureusement, les rats sont sortis de leur tanière pour projeter sur eux leurs fantasmes, et ils étaient issus de bonnes familles, ces gosses, donc ils se sont mis à rationaliser. Se retrouver à 14 ans dans les journaux, c’est pas possible. Le monde des adultes et Rock and Folk les ont récupérés. Dommage. »
Ses nuits : « J’ai toujours été attirée par les clubs. J’ai commencé à sortir à 13 ans, en cachette, mais mes parents s’en sont aperçus. J’allais au Palace des années 90, aux Bains-Douches, au Rex. Le samedi matin, j’allais à l’infirmerie du lycée pour dormir. En 96, mes copains étaient les Daft Punk et leur bande, on allait aux soirées Hometown du Rex, ou dans les raves des Transmusicales de Rennes, c’était fantastique, et ça m’impressionnait. Ensuite je suis devenue ingénieur du son. J’ai commencé à organiser des soirées tard, à 25 ans ! C’était avant tout pour mixer, et faire mixer mes amis, avec une idée assez “totalitaire” de ce qu’est une bonne fête : programmer des groupes électro jeunes qu’on voyait peu à Paris, comme les Bloody Beetroots, proposer des thèmes et des dress codes créatifs, faire en sorte que tout soit beau, même avec un petit budget. Le Social Club nous a rapidement invités en résidence mensuelle. Notre public, très fidèle, ce sont des trentenaires comme des “kids”, parfois lycéens attirés par cette espèce d’énergie folle, des jeunes déguisés qui se défoulent les bras en l’air, adorent les artistes, se hissent sur la scène, se jettent dans la foule comme dans les concerts de hard rock d’il y a vingt ans. En parallèle, on a développé Flash Cocotte, une soirée “queer” déguisée qui cartonne. J’y ai mixé en robe de mariée ou en Lady Gaga… Je continue de tourner en tant que DJ et avec Numéro 6, mon partenaire dans le crime, j’ai crée un groupe électro mélodique, Bagarre. Une nuit : « Ou plusieurs… L’une des premières Furie, on a programmé les Crystal Castles en live, c’était l’hystérie, les gens s’évanouissaient, on a eu des articles disant que c’était la soirée de l’année. En 2009, on a choisi le thème H1N1. Les gens ont tous joué le jeu et sont venus en docteur, infirmier, malade, cochon, Mexicain, et même en boîte de Tamiflu… »